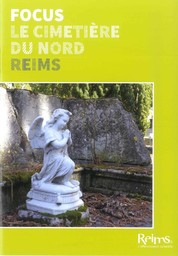L'abbé Charles Eugene Miroy (1828-1871)
Portrait
Le gisant de l'abbé Miroy
Biographie
L'histoire de l'abbé Charles Eugene Miroy (1828 - 1871) est un témoignage marquant des crimes de la guerre franco-allemande de 1870-1871 dans la région rémoise.
La vie de l'abbé
Charles Eugene Miroy est originaire de Mouzon où il nait le 24 novembre 1828. Doté d'un esprit vif, il se passionne pour d’innombrables domaines. Dessinateur, sculpteur sur bois, il laisse derrière lui de nombreuses sculptures de saints dans l'église de Montmeillant où il exerça avant de devenir prêtre de Cuchery. Son approche du sacerdoce se développe lors de ses études au séminaire, mais c'est surtout au contact de ses paroissiens qu'il trouve sa vocation.
Il est dit de l'abbé qu'il "aimait Dieu et la France" et qu’il ne se limitait pas à des prières pour œuvrer dans la résistance face à l'armée prussienne. Ainsi, même si sa fonction lui interdit de prendre les armes, il se tient aux cotés des résistants plutôt que de sa hiérarchie. Les soutenant, s'occupant des affaires du village, partageant leurs doutes et enhardissant leur volonté à défendre leur patrie allant même jusqu'à les aider, ce qui lui vaudra sa condamnation à mort.
Les évènements
Le déroulé des événements qui mènent à sa condamnation est retranscrit par divers auteurs. Le maire de son village est favorable aux prussiens et trouve son compte auprès d'eux, tandis que Miroy est bien plus résistant dans l'âme. Certains historiens parlent de machinations du maire envers l'homme d'église.
L'abbé Miroy aide les pompiers du village à conserver leurs fusils qui risquent d'être confisqués par les prussiens, au sein de son église. Suite à cette affaire, les clefs du lieu de culte sont volées, empêchant l'abbé de faire messe, et des lettres menaçantes lui sont envoyées. Il le dénonce lors d'un prêche, quelques jours avant les événements, sachant que cela provient du maire et de ses amis qui ne se cachent pas et s'en félicitent. Il lui est demandé de s'excuser au conseil municipal, ce qu'il refuse de faire. Les fusils sont récupérés par leurs propriétaires.
Quelques jours plus tard, des coups de feu sont tirés dans le village voisin de Belval à l'approche de soldats prussiens et le nom de l'abbé y est évoqué.
Il est alors directement emmené au tribunal par la troupe prussienne, déclaré prisonnier de guerre et jugé sans possibilité de défense. Il est mis à mort le soir même du 12 février 1871. Son ami l'abbé Jules Sacre l'assiste dans ses derniers instants et en livre un touchant témoignage. Malgré une armée généralement protestante, les soldats choisis pour composer le peloton d'exécution sont tous catholiques. Ce détail marque alors profondément les Rémois, d'autant plus que le chef du peloton serre la main et s'excuse auprès de l'abbé, qui lui pardonne, avant de donner l'ordre de tirer.
Réaction des Rémois et de René de Saint-Marceaux
Un fonctionnaire du palais de justice invective le maire qui arrive au procès : " vous venez accuser votre curé, vous feriez bien mieux de venir le défendre". Cette vive réaction donne le ton, l'idée générale que s'en font les habitants.
Le maire de Reims et l'évêque ne sont informés de son exécution que le lendemain des événements. Des employés du cimetière sortent le fusillé de la fosse commune et une souscription est très vite lancée par les Rémois pour faire perdurer sa mémoire. Le docteur Adolphe Hanrot propose au sculpteur René Saint-Marceaux de se charger de la confection d'une sépulture pour l'abbé. L'œuvre, jugée très politique dans un climat tendu avec la Prusse n’est pas exposée au Salon (Plus importante exposition annuelle des peintres et des sculpteurs issus de l'académie et des beaux-arts au 19e siècle.) mais y est tout de même récompensée.
"Sa figure, endormie dans la mort, n'est ni farouche, ni menaçante : elle n'est pas l'image de la colère ; elle n'est pas non plus celle d'une lâche résignation ; c'est celle de la protestation du droit et de l'humanité, protestation d'autant plus ferme qu'elle est plus calme, qu'elle ne se dépense pas en menaces et en paroles, et que, sans braver la force triomphante, elle n'abdique pas devant elle ... Ce sentiment, qu'un artiste distingué, qu'un enfant de Reims dont nous sommes déjà fiers, a su traduire dans son œuvre, ceux qui en ont eu l'inspiration et l'initiative, le partageaient avec lui."
Discours prononcé par Victor Diancourt, maire de Reims, lors de l'inauguration du Gisant au cimetière du Nord le 17 mai 1873, il démontre toute la sensibilité et l'attachement aux valeurs qui émanent de cette histoire et de cette sculpture. L'abbé Miroy a ainsi pu traverser les âges, devenant malgré lui un symbole et une figure locale.
Le gisant de l'abbé Miroy
Son gisant, situé dans le canton 16 du cimetière du Nord, est fleuri chaque année par la mairie et les habitants, montrant ainsi l'impact que sa "mort injuste" a dans la mémoire collective.
- 1871 : juin, une souscription est lancée.
- 1872 : la statue est envoyée au Salon, mais non exposée, à la demande de Thiers. On craint en effet, dans le contexte de l’immédiat après-guerre, d’éveiller la susceptibilité d’un ennemi toujours menaçant par des oeuvres considérées comme trop ‘chauvines’. Le sculpteur obtient toutefois une deuxième médaille.
- 1873 : 24 mai, inauguration
- 1918 : la statue est évacuée à Dijon grâce à M. Linzeler et à l'intervention du général Gouraud
- 1922 : remise en place après l'exposition Saint-Marceaux à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris
- 1940-1944 : la mairie fait déposer le bronze et l'entrepose dans une réserve pour le soustraire aux Allemands. Après la guerre, l'abbé Miroy retrouve sa place au cimetière
- 2006, pour des raisons de conservation le bronze est transféré au musée des Beaux-Arts de Reims
- 2018 : 17 mai, inauguration au cimetière du Nord de sa copie en résine.
Historique de la sculpture, par le musée d’Orsay.