Le Polar Vintage
Pierre Siniac (1928-2002)
Auteur d’une cinquantaine de romans et de nouvelles il a reçu le Grand Prix de littérature policière en 1981 pour un roman Aime le Maudit et deux recueils de nouvelles L’Unijambiste de la cote 284 et Reflets changeants sur mare de sang.
Dans l’Almanach du crime 1984 , il s’amuse à répertorier tous les surnoms qu’on lui attribue dans la presse spécialisée ou non:
le Maître du polar bizarre, le moraliste du polar, l’auteur de polars le plus original et remarquable des vingt dernières années, le grand déboucheur de chiottes du polar.
Une tentative de biographie
De nature discrète et réservée, c’est dans sa correspondance avec Jean-Patrick Manchette que Pierre Siniac (pseudonyme de Pierre-Mitsos Zakariadis) se révèle.
Il y dévoile son goût pour le cinéma, son travail d’écrivain, sa volonté d’indépendance. Cette chronique s’appuie en très grande partie sur les lettres échangées entre Siniac et Manchette au cours de l’année 1977 [1]
Le 22 septembre 1977, dans une lettre adressée à Jean-Patrick Manchette, Pierre Siniac brosse ainsi son portrait :
Je suis né à Paris [en 1928], j’ai vécu quarante ans dans le 16ème arrondissement avec une escapade de trois ans dans le quartier Bastille. […]J’ai beaucoup voyagé entre 15 et 40 ans. Je suis célibataire, par esprit d’indépendance, de liberté. J’aime foutre le camp une semaine sur les routes, sans prévenir, ça me prend brusquement, je n’aime pas donner d’explications, etc. Cela dit, je ne suis absolument pas misogyne, bien au contraire. Je pense être fait pour le célibat. Je vis un peu comme le fauve dans sa tanière, j’ai des habitudes, je suis maniaque-Une femme serait très malheureuse avec moi dans de telles conditions-Mes parents étaient des petites gens […] aux goûts simples, et qui ont vraiment fait le maximum pour leurs enfants. [..] Mon enfance fut très heureuse et surtout fort amusante car notre famille était non conformiste. [Siniac précisa dans une note plus tardive que le vrai chef de famille fut toujours sa mère], et les enfants avaient une liberté presque totale. Bref mon enfance fut heureuse, pleine d’imprévus, très riche. Je ne foutais rien en classe, ça m’emmerdait, je fuguais. [...]J’ai mené une vie de vagabondage ex-tra-or-di-naire. A 25 ans, j’étais toujours sans profession. J’ai énormément voyagé, le plus souvent en stop. J’écrivais. Poèmes, contes…Mes deux premiers romans (très noirs) à l’âge de 10 ans. Puis des paroles de chansons [2] . Puis des scénarios. Je me suis lancé dans le théâtre, je suis devenu régisseur. Mon premier roman publié : en 1958 [3] . Quelques autres ont suivi, des polars…[chez des] petits éditeurs […] et entrée à la Série Noire puis JC Lattès et nous voici arrivés aujourd’hui [en 1977]. J’ai quitté Paris en 1972 et j’habite ici à 45 bornes de Paris à Aubergenville (Yvelines).
[1] Revue Polar Hors-série Spécial Manchette, 1997. Correspondance avec Jean-Patrick Manchette 22/09/1977 (p.164-169) - Disponible à la bibliothèque Carnegie.
Ou Lettres du mauvais temps : correspondance 1977-1995 / Jean-Patrick Manchette. - La Table ronde, 2020 - Disponible à la médiathèque Jean Falala.
Siniac précise que ses lettres datent de 20 ans, qu’il les a annotées depuis et qu’elles ont été écrites au fil de la plume, sans avoir été relues avant l’envoi et que elles ne constituent qu’une partie de sa correspondance avec Manchette.
[2] Bastille-Saloon et Les bals de société, revue 813, les Amis de la littérature policière, n°83, février 2003 (p.20.21) disponible à la bibliothèque Carnegie.
[3] Illégitime défense, Arabesque Policier, n°19
La mort de Siniac elle-même est rocambolesque et je vous invite à lire l’intégralité de l’article de Philippe Lançon paru à l’occasion de sa mort en 2002 [4] dont est repris un extrait ici :
« Locataire, il y a vécu avec sa mère puis seul. Mort depuis environ 1 mois de mort naturelle. L’odeur a fini par alerter la voisine d’en face. Siniac est signalé comme un sauvage ; dur d’oreille et à la confidence ; chez qui personne, pas même ses éditeurs, n’a mis les pieds. Appelée, La mairie n’a pas trace. On ne sait même pas qu’un auteur du nom de Siniac existe et vit depuis 30 ans dans la commune. Il ne s’est jamais fait connaitre et n’a pas figuré aux fêtes locales du livre. Le libraire, le bibliothécaire ne possède aucun de ses livres. Une voisine conclut : « j’ai regardé dans le catalogue de France Loisirs, mais il n’y a rien de lui. C’est quand même dommage : on avait un écrivain et on l’a jamais lu. »
Jean-Jacques Reboux dans un ultime hommage le décrit ainsi :
« L’image que je garde, c’est celle de quelqu’un capable de vous écrire un carton de gentillesse quand votre chatte Lulu s’est fait écraser par une bagnole, de vous engueuler sévère au téléphone jusqu’à raccrocher, en pétard pour une broutille, et de rattraper le coup avec un petit mot plein de regrets […] Siniac, c’était ça : un caractère de cochon, une soupe-au-lait toujours à la limite de l’envolée, un goût certain pour le secret, la solitude, une humanité rentrée, une tendresse bourrue et, pour ce qui me concerne en tout cas, une grande attention et une grande générosité » [5] .
[4] Philippe Lançon, Sang pour sang Siniac, Libération du 20/06/2002
[5] Pierre Siniac, écrivain de la démesure et de l’imaginaire, Jean-Jacques Reboux, 813 les amis de la littérature policière, 21 septembre 2002.
L'art d'écrire du polar
« Je fais toujours un truc que j’aimerais lire ; en somme je m’offre une histoire que j’aurais aimé lire chez un autre auteur. »
Siniac a publié une cinquantaine de romans. Dans sa correspondance avec Jean-Patrick Manchette, il revient sur sa méthode de travail :
« Les thrillers, je les écris à chaud, disons à la hussarde. Dès que j’ai une idée en tête, je bombarde des pages à toute allure, comme un dingue. Je crache tout ça en vivant l’action. Il en résulte de courtes nuits de sommeil, je bouffe à peine. Bref, ça se fait en six-sept ou huit jours […] » [1]
Au cours du temps, sa façon d’écrire change d’une manière très nette comme il le souligne en 1997:
« Aujourd’hui pour faire un livre je prends mon temps. J’ai passé 6 mois pour mon nouveau roman. Le premier jet effectué, je m’installe, c’est très lent, j’aime rester dans mon livre (ce qui n’était pas du tout le cas il y a vingt ou vingt-cinq ans). Cette écriture rapide me semble nécessaire pour apporter un rythme nerveux et une spontanéité au thriller qui a l’ambition d’être lu sans pauses ou presque. Pour moi, un thriller bien écrit, bien foutu, est avant tout un thriller qui se lit vite, qui n’endort pas le lecteur ».
[1] L’Almanach du crime 1982, l’année du roman policier. Michel Lebrun/Veyrier polar, 1981. p. 310.
A lire sans tarder
Barbara, jeune femme originaire du Nord, est venue se réfugier en Normandie dans le château du comte d’Auvarqueville. Sous les bombardements de juillet 44, elle parcourt des kilomètres dans une vieille Delage pour trouver de quoi nourrir les huit orphelins dont elle a la charge. Au cours de son périple, elle rencontrera des petits commerçants pingres et avides qui profitent du marché noir, des soldats intrigués par le passage incessant de la voiture dans Saint-Lô totalement détruite, et un misérable chien jaune.
On sent la tendresse de Siniac pour son héroïne et même une certaine admiration pour cette petite bonne femme butée mais bien déterminée à atteindre son but. Nous la suivons sur les routes qu’elle sillonne avec le fervent espoir qu’elle réussisse.
A signaler, Siniac écrit dès l’ouverture du livre que la toile de fond de son livre a été empruntée à des faits réels.
Siniac nous entraîne avec un humour caustique dans la vie d’une petite ville de province qui sent bon la naphtaline. Chacun garde ses petits secrets, avouables ou non, et vit selon un scénario bien établi. Que celui-ci se dérègle et tout part à vau-l’eau ! Jubilatoire !
Autant de membres, affublés chacun du nom d’un assassin célèbre et poursuivant un seul objectif : aboutir au fauteuil n°1, tuer un inconnu quand viendra leur tour, puis se dénoncer afin d’expier ce crime. Mais le jour J arrivant, les apprentis assassins manquent parfois de courage. Qu’à cela ne tienne, on se chargera de leur forcer la main…
Chef d’œuvre d’humour noir, nous voilà captivés et tenus en haleine pour comprendre la motivation d’honnêtes citoyens à se changer en assassin et finir exécuté. Vous n’aurez la réponse à ce mystère qu’à la toute fin du livre…
Aime Le Maudit fait partie des trois titres pour lesquels Siniac remporta le Grand Prix de Littérature policière en 1981. Michel Lebrun dans son Almanach du crime 1982 souligne que ce roman « fut refusé par des tas d’éditeurs et moisissait depuis quinze ans dans les tiroirs de l’auteur ».
Suicide ? Il était trop petit pour accrocher au plafond la laisse de son chien avec laquelle il a été retrouvé pendu.
Meurtre ? Il était seul à la station précédente. L’enquête s’annonce compliquée…
Ce titre est paru dans la collection La Baleine Série grise et s’inspire d’un fait réel datant de mai 1937 qui ne fut jamais élucidé. En 160 pages, Siniac entraine le lecteur dans un enchainement de faits mené tambour battant.
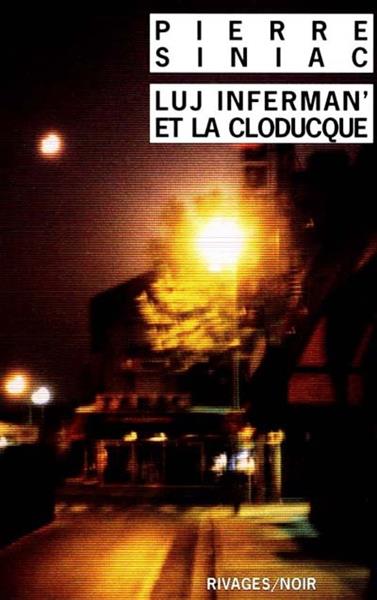 La série des Luj Inferman et la Cloducque
La série des Luj Inferman et la Cloducque
C’est à la demande de Robert Soulat alors directeur de la Série Noire que Siniac imagina ses deux personnages loufoques.
Luj inferman, la quarantaine bien tassée, vagabond, erre de petits boulots en petits boulots et ne crache pas sur une escroquerie ou deux. Sur sa route, il rencontre La Cloducque, sorte de monstre hermaphrodite d’un âge indéterminé, mangeur d’oiseaux crus et vêtu d’un sempiternel « lardeuss ». Siniac leur invente sept histoires totalement déjantées toujours à la limite de l’absurde.
Siniac avouera à Manchette que « Ce sont les Luj qui demandent, je pense, le plus gros travail. Ici il me faut des semaines et des semaines, et c’est souvent abandonné en route. C’est fait par petites touches, repris et repris, plusieurs fois… Je trouve toujours du nouveau, les Luj ne sont jamais vraiment terminés, je pourrais reprendre le premier et le transformer, en remettre etc. je ne m’explique pas pourquoi. Mais faire du Luj est pour moi est un grand régal car il m’arrive de me faire éclater de rire. C’est tellement con et énorme, tordu, disloqué que du grotesque nait une sorte de comique assez spécial, ahurissant. C’est surtout La Cloducque qui m’amuse. Quand je tiens une vingtaine de situations Lujiennes, je passe à l’écriture, les enchainements, les dialogues viennent facilement. Mais me dire « il faudrait que je fasse un Luj » est épouvantable, car je sens que ça va être impossible ; mais dès que je suis fourré dedans, je ne veux plus en sortir[…] ».
Voir les aventures de Luj Inferman et la Cloducque dans les collections de la bibliothèque
Siniac et la BD
Ce premier épisode met en scène le célèbre duo crée par Siniac Luj Inferman et La Cloducque, embrigadés par un commissaire véreux pour aller déterrer de nuit plusieurs « macabes assez frais » dans un cimetière.
Un extrait pour vous mettre l’eau à la bouche…
« Les tombes vidées étaient soigneusement rebouchées. Les familles n’y verraient que du feu (sans jeu de mots, ah ! ah ! ah !). Et puis, ce boulot, La Clod’ aime assez. Elle grapille toujours quéque chose sur le macabe…Une boucle d’oreille…Un œil de verre…Un anus artificiel…On peut r’vendre tout ça à la grande braderie de Lille… »
Prévue à l’origine pour être illustrée par Poussin pour un mensuel mort-né, cette BD ne paraitra jamais .
Paris, 1959. Un brouillard épais s’est installé durablement sur la capitale. La police a déposé un préavis de grève pour une semaine. Monsieur cauchemar en profite pour assassiner les honnêtes gens qui osent déambuler dans les rues à la nuit tombée…
La bande dessinée s’ouvre sur les actualités de février 1959 telles qu’elles paraissent dans les journaux afin de mettre le lecteur dans l’ambiance de l’époque. Entièrement en noir et blanc, elle révèle l’atmosphère lugubre et poisseuse du roman avec la poursuite de la victime par l’assassin dans les rues dans un brouillard intense. Très fidèle au roman, la BD s’achève sur plusieurs fins possibles : « deux fins inacceptables » et « une fin apparemment inexplicable ».
Monsieur Cauchemar se déroule dans le monde du petit commerce, le meurtrier, bouquiniste, est spécialisé dans la vente de romans policiers d’occasion. Les personnages qui gravitent autour de lui sont des gens ordinaires, issus d’un milieu où on subit la situation plus qu’on ne la contrôle et où l’on craint toujours les fins de mois.
Pour coller à l’atmosphère du roman, Tardi commence par un travail de repérage dans les rues de Paris (prises de photos d’immeubles, d’escaliers…), lieux où va se dérouler l’action, dans le brouillard, toute la subtilité étant de suggérer leur silhouette au lecteur. Le visionnage de films des années 60, proche des préoccupations sociales, lui a également permis de retrouver cette ambiance à la Burma qui lui est chère, notamment avec le film d’Henri Verneuil, Des gens sans importance (1956), où il reprend pour l’illustration d’un des personnages la position de Jean Gabin dans un bistrot parisien, la main crispée sur le comptoir. Du film, il s’est également inspiré des décors avec la station-service, le bistrot routier, le passage du train, la vie des petites gens, tout ce que révèle le film. Il utilise des décors réels pour rendre l’histoire vraisemblable. Il se replonge dans l’ambiance générale de l’époque avec la consultation des journaux parus l’année du crime, avec ses actualités, ses publicités pour l’électro-ménager ou les voitures, les programmes de cinéma, ses informations annexes qui sont dans l’air du temps….
Adapté du roman du même nom paru en 1985.
Carton blême est un polar futuriste où tous les citoyens possèdent un carton à l’issue d’un check up devenu obligatoire : de couleur bleue il signale que le citoyen est bien portant, blême qu’il ne l’est pas. De cette couleur dépend sa survie : bleu, il aura droit à l’assistance de la police. Blême, il devra se débrouiller seul… Mais dans cette société arbitraire, tout se trafique même les cartons, Paul Heclans, inspecteur de police, enquête sur cette nouvelle forme d’escroquerie qui permet aux uns d’être protégés et aux autres d’être livrés à eux-mêmes. Cauchemardesque, ce roman de Siniac se dévore et on se demande jusqu’où l’abomination d’une telle société peut mener. Toute ressemblance avec la situation actuelle est fortuite…
Pour moi, un des meilleurs romans de Siniac !
La BD est beaucoup plus légère et a du mal à rendre l’atmosphère hideuse et le malaise que le lecteur peut ressentir à la lecture des situations cauchemardesques que les personnages subissent dans le roman.
En juin 1940, en pleine débâcle, un fourgon blindé avec deux tonnes d'or à son bord doit être acheminé de Saint-Ouen à Bordeaux pour échapper aux allemands. Une bande de pieds nickelés décident de le suivre sur les routes et de l’intercepter pour s’emparer du magot. Mais rien ne va se passer comme prévu…
Ce scénario est librement adapté du roman Sous l’aile noire des rapaces paru en 1995 (paru initialement en 1975 sous le titre L’or des fous). On suit avec plaisir ces aventuriers à la morale élastique sur les routes de l’exode. Bombardements, pétarades, mauvais coups en tous genres pleuvent dans cette BD très rythmée et efficace. A noter la présence d’un personnage féminin qui n’existe pas dans le roman initial.
Siniac et le cinéma
Siniac a collaboré à l’adaptation de son roman éponyme en signant le scénario avec Michel Audiard.
A l’origine c’est un remake du film américain De l’or pour les braves. Le film n’a pas soulevé l’enthousiasme de la critique, loin s’en faut, mais il se laisse regarder si on laisse la vraisemblance des faits au placard et si on aime l’humour et les cascades de Bébel.
Passionné de cinéma, Siniac confiait son admiration pour le cinéma noir américain
(côté français, il admirait Labro « à qui [il] trouve une dimension « ricaine » et c’est un compliment » et se déclare un inconditionnel de Chabrol).
Dans une lettre adressée à Jean-Patrick Manchette datée du 28 juillet 1977, il revient sur sa vision du cinéma :
[…] Quant aux héros, je les trouve plus forts - ils ont plus d’impact - quand ils sont « non positifs », ils sont plus « spectaculaires ». C’est un simple avis personnel et jusqu’à nouvel ordre. Je reste en admiration devant le cinéma américain. […]
Si les américains avaient tenu ce raisonnement, un tiers des grands films noirs américains n’auraient pas vu le jour outre-Atlantique. Chez nous, le plus grand héros « noir » - qui a passionné les foules -est « négatif » : Fantômas. […]
De plus, avec cette optique « timorée », M le Maudit ou Scarface (et tant d’autres) n’auraient pas vu le jour. Ce qu’il me faudrait-ce qu’il nous faudrait-, c’est un Fritz Lang ou un Huston […].
Je me demande ce qu’on attend pour faire de tels films en France ! Je trouve que - peut-être pas les metteurs en scène - mais nos producs manquent singulièrement d’audace ; on dirait qu’ils ont peur d’un certain public gnan-gnan. Je suis sûr qu’un film noir français avec « héros négatif» bien fait, avec talent, marcherait. En ce qui me concerne, je ne veux pas faire de concessions - enfin pas trop - car je crois fermement au héros noir négatif […].
On manque aussi d’acteurs qui soient de vrais acteurs, n’hésitant pas à jouer les « durs » ou les « salauds ». Pense aux Ricains. Bogart n’a jamais refusé de jouer les gangsters (Maison des otages).
J’ai bien vendu les droits ciné de trois bouquins mais deux n’ont pas été tournés à ce jour […]. Le troisième a été massacré à la télé (les Monte en l’air d’après les Monte-en-l’air sont là). J’avais fait l’adaptation (je m’étais contenté de suivre le livre) mais ils m’ont presque tout sabré pour ne pas effaroucher le public . Et ce genre de chose -la critique mauvaise - n’apporte pas de nouvelles commandes.
[Siniac détaille ensuite ses déboires avec l’adaptation de ses films et se plaint que le cinéma français manque de producteurs].
Sur l’adaptation du premier Luj : « Le travail terminé, le producteur a fait demander si je ne sortais pas d’un asile d’aliénés-et pourtant nous avions gommé de façon importante, au risque même d’esquinter le sujet. Voici les mésaventures d’un auteur pop en 1977 - auteur qui en a un peu ras le bol ».
Sans oublier les critiques de cinéma pour lesquels il garde son franc parler : « Ces critiques de ciné, je suis rarement d’accord avec eux, ou pas pour les mêmes raisons. Quand je lisais leur prose avant de voir le film, bien souvent ma « salivation » était asséchée, tuée dans l’œuf. Il faut dire que ses « juges »sont fréquemment rabat-joie, surtout pour les films de « divertissement » comme ils disent (chez eux le terme semble péjoratif). Et puis ils révèlent toujours des trucs que l’on préfère découvrir devant l’écran. Parfois – incroyable - parce que Monsieur Untel n’aimait pas tel film, je renonçais à voir de mes propres yeux ! »
Dans le recueil de nouvelles intitulé Noir Scénar , Jean-Baptiste Baronian a demandé aux écrivains ayant collaboré à ce volume de répondre à trois questions concernant le cinéma.
Voici les réponses de Pierre Siniac :
Quels sont vos trois films préférés ?
Quelle est votre musique de film préférée ?
La musique de Quai des brumes composée par Maurice Jaubert
Quel est le roman ou la nouvelle dont vous êtes l'auteur et qu'on devrait porter à l'écran, et quel serait le réalisateur le plus indiqué pour tourner ce film ?
Les âmes sensibles réalisé par Roman Polanski